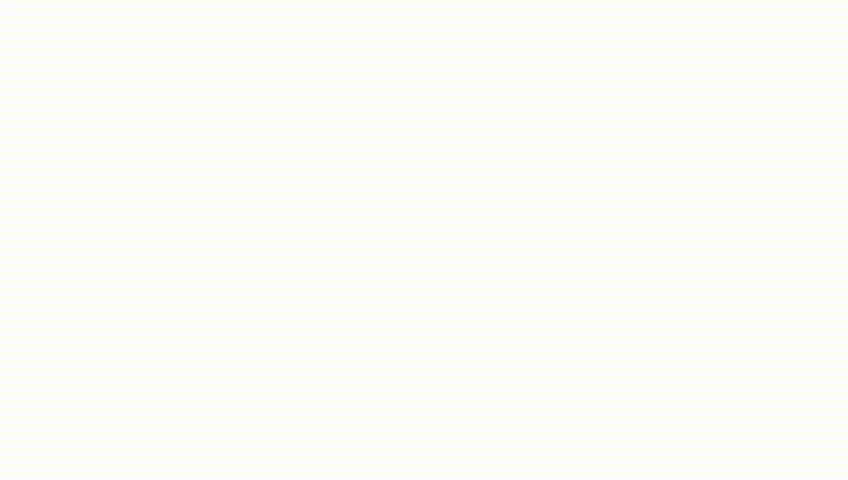Depuis l’invasion de l’Ukraine, une même question se bouscule sur toutes les lèvres : que se passera-t-il si Vladimir Poutine remporte sa guerre ? Et les avis sont aussi nombreux que les craintes. Et si, une fois n’est pas coutume, on retournait le problème ? Que se passera-t-il si le maître du Kremlin est battu ? L’Ukraine concentre des intérêts impériaux et impérieux. « L’absence de prospérité et l'hypertrophie impériale ont provoqué la chute de Rome. Des trois grandes puissances actuelles, l'empire de Poutine sera le premier à disparaître ». Mais qui d'autre est voué à la destruction ? « Le dénouement du conflit russo-ukrainien sera déterminant pour les États-Unis et la Chine », assure l’historien et théoricien militaire Martin van Creveld dans les pages de Die Welt. Le tout sans avoir (ou presque) déboursé de leur budget de défense ni perdu le moindre soldat sur le champ de bataille. Quelle vision stratégique ! « Les pays du Vieux Continent, en revanche, seront désavantagés quel que soit le vainqueur ». Tireront leur épingle du jeu : les States et le pays du soleil levant.
Le philosophe Platon (428-348 av. J.-C.) et l'homme d'État et historien Polybe (env. 200-118 av. J.-C.) le savaient bien, les grands empires se font et se défont. L'empire babylonien est né et s'est effondré. L'empire perse est né et s'est effondré. L'empire macédonien d'Alexandre est né et s'est effondré. Au premier siècle avant Jésus-Christ, l'idée que l'Empire romain finirait lui aussi par s'effondrer était largement répandue parmi les habitants cultivés du pays ; comme l'écrivait l'un d'entre eux, l'historien romain Livius, « l'Empire lutte contre sa propre grandeur ». Il n'y avait cependant pas d'accord sur la date de sa chute, et encore moins sur la manière dont elle interviendrait.
En ce qui concerne le monde gréco-romain, la raison la plus souvent invoquée pour expliquer son déclin est peut-être l'idée que le pouvoir et la prospérité se sapent eux-mêmes. Plus un empire devenait puissant et prospère, plus ses citoyens s'adoucissaient, plus ils s'adonnaient au vin, aux chants et aux femmes et moins ils étaient prêts à servir, à se battre et à mourir pour leur patrie.
Cela ne suffit plus
A la fin de l'Empire romain, cela allait si loin que les soldats se mutilaient eux-mêmes pour échapper au service militaire ou à la mort sur le bûcher qu'un tribunal pouvait imposer comme punition pour refus de servir. Tôt ou tard, on en arrivait à devoir recourir à des étrangers pour défendre l'Empire contre ses ennemis. Mais tôt ou tard, ces étrangers devenaient également un fardeau, soit parce qu'ils ne se battaient pas assez durement, soit parce qu'ils se retournaient contre leurs employeurs.
Depuis lors, de nombreuses autres explications ont été avancées pour expliquer la chute d'un empire. Le péché ou, dans la plupart des religions non abrahamiques, le respect insuffisant des rituels religieux qui font fonctionner le monde, auraient poussé Dieu à se détourner. Les guerres civiles, souvent le résultat de différences religieuses, d'une taxation excessive ou des deux, auraient conduit à l'effondrement de l'ordre public. Des personnes à l'esprit égoïste, surtout parmi les classes supérieures, auraient refusé d'avoir et d'élever des enfants.
« Surextension impériale », un terme popularisé par l'historien Paul Kennedy dans son livre « Ascension et déclin des grandes puissances » paru en 1987, désigne la situation dans laquelle les ressources matérielles et humaines de l'empire ne suffisent plus à remplir ses fonctions. L'utilisation excessive et l'abus des ressources naturelles ont entraîné la déforestation et la désertification, pour ne pas dire l'empoisonnement de régions entières, voire de pays. Les catastrophes naturelles ont augmenté en fréquence et en gravité. Souvent, plus d'une cause ou une série de causes sont à l'œuvre - toutes entremêlées et se renforçant mutuellement dans un cas, se contredisant dans l'autre.
La Russie tombe la première
Comme George Orwell l'avait prévu avec une précision presque inquiétante dans sa dystopie 1984, le monde dans lequel nous vivons est divisé en trois immenses empires : les États-Unis et leurs vassaux (Océanie), la Russie (Eurasie) et la Chine (Asie de l'Est). Le premier empire se définit par sa richesse, le mode de vie libéral et démocratique, dont ses membres sont fiers, et sa volonté de promouvoir et d'appliquer le progrès scientifique et technique. Le deuxième se définit par sa simple taille géographique, sa puissance militaire et la capacité de ses habitants à faire face à l'adversité. Le troisième des empires actuels se caractérise par l'énorme nombre et le travail acharné de sa population, qui, selon certains chercheurs, est aussi en moyenne la plus performante de toutes. Là encore, tous les facteurs cités se mélangent et se renforcent mutuellement d'innombrables façons différentes - bien trop nombreuses pour qu'il soit possible d'en faire plus qu'une simple mention ici.
Passons maintenant à la question des cent mille milliards de dollars (c'est le montant du produit national brut annuel de tous les États du monde réunis) : Comme aucun empire n'est éternel, lequel des empires actuels s'effondrera le premier ? Ma réponse serait : la Russie. Premièrement, sa population de 143.000.000 d'habitants est de loin la plus petite et diminue rapidement. Deuxièmement, un peu plus d'un cinquième de cette population est non russe, non slave et même non chrétienne. Initialement soumise par la force des armes, une partie d'entre eux pourrait, dans de bonnes circonstances, se soulever contre Moscou, et faire éclater l'empire. Dans ce cas, pour citer le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Selenskyj, il ne resterait que la « Moscovie ».
Troisièmement, la Russie est immensément riche en ressources naturelles et dispose d'une énorme industrie de l'armement. Pour des raisons obscures, elle n'a cependant jamais été en mesure de développer une industrie forte, axée sur la consommation, qui constitue depuis le XIXe siècle l'épine dorsale des économies modernes et le type de prospérité qu'elles seules semblent être en mesure de générer. Quatrièmement, la Russie n'a toujours pas de véritable accès à la mer et donc au commerce mondial, dont la Grande-Bretagne d'abord, puis les États-Unis ensuite, ont bénéficié pendant des siècles.
Le cauchemar de Poutine
Enfin et surtout, la Russie est géographiquement coincée entre les deux autres empires. Pour l'instant, ces empires sont des rivaux acharnés qui se disputent presque tout, de l'Ukraine à l'ouest à Taïwan à l'est. Il n'en a toutefois pas toujours été ainsi. Souvenez-vous de l' « ouverture de la Chine » du président Nixon au début des années 1970. La crainte d'une collusion entre Washington et Pékin - qui ne pouvait que se retourner contre Moscou et qui l'a fait - a même joué un rôle dans l'effondrement de l'Union soviétique moins de vingt ans plus tard. Un nouveau rapprochement de ce type est le cauchemar de Poutine. Si les Etats-Unis et la Chine s'unissent, comme ils l'ont fait contre le Japon en 1941-45, le Kremlin ne pourra guère faire autrement que de menacer les autres, et donc lui-même, d'anéantissement nucléaire.
Ensuite, les Etats-Unis : les Etats-Unis comptent environ deux fois et demie la population de la Russie. Si l'on ajoute les alliés de l'OTAN, la différence est de presque six pour un. Si l'on ajoute le Japon, la Corée du Sud et l'Australasie, le rapport passe à environ sept pour un. Pratiquement tous ces gens sont là où ils sont parce que, contrairement aux Russes, ils le veulent. Leur loyauté est basée sur le consentement plutôt que sur la violence. C'est un avantage dont très peu d'empires antérieurs ont bénéficié.
Certes, l'industrie américaine en particulier n'est plus ce qu'elle était entre 1945 et 1970, quand elle éclipsait facilement le reste du monde. Mais elle reste extrêmement performante, notamment dans le domaine de l'innovation. Il faut également tenir compte du fait que le membre central de l'Alliance atlantique, à savoir les États-Unis, est un îlot mondial. Du côté positif, cela signifie que toute tentative d'invasion des États-Unis continentaux doit rester un vœu pieux. Du côté négatif, cela signifie que les États-Unis ont besoin des communications maritimes pour compléter leurs propres ressources et maintenir leur influence mondiale. Ces communications ne sont pas seulement plus faciles à contrer que celles par voie terrestre - la marine américaine est même en train de perdre sa suprématie au profit de la Chine. Cela est d'autant plus vrai que l'on se rapproche des côtes chinoises. Une autre faiblesse de l'Amérique est l'ampleur de ses déficits, tant au niveau du commerce extérieur que de son propre budget. Des déficits qui, s'ils ne sont pas traités, provoqueront certainement l'effondrement économique non seulement des Etats-Unis, mais aussi d'une grande partie du reste du monde.
Les civilisations ont une longue durée de vie
Et pour finir, la Chine. Comme toute personne ayant voyagé en Chine peut facilement le constater, l'industrialisation de la Chine au cours des dernières décennies est l'un des plus grands, peut-être même le plus grand miracle de l'histoire. Au cours de cette période, sa part du PIB mondial (calculé en PPA) a été multipliée par plus de dix, passant de 2,26 à 27 pour cent. Le principal obstacle à la capacité de la Chine à peser dans le monde est sa géographie, en particulier sa géographie maritime. Dans l'océan Pacifique, les navires commerciaux et de guerre chinois sont flanqués par le Japon, Taïwan et la Corée du Sud, et dans l'océan Indien par les Philippines et le détroit de Sumatra. Chacun de ces flancs est un porte-avions insubmersible. Xi Jinping lui-même est bien conscient de ces faits. En témoigne notamment l'initiative qu'il a lancée d'une « nouvelle route de la soie », dont l'objectif est de contourner par voie terrestre les liaisons maritimes problématiques de son pays
En outre, l'ascension de la Chine a entraîné la formation d'une coalition lâche d'autres pays autour de ses frontières, menée par les États-Unis ; que ce soit par sa propre faute ou par celle d'autres pays, Pékin a désormais des différends territoriaux avec chacun de ses quatorze voisins. D'autres points faibles sont la baisse du taux de natalité, qui fera que la population du pays sera bientôt dépassée en nombre par celle de l'Inde ; après des décennies de politique de l'enfant unique, le pays manque de jeunes travailleurs pour l'industrie et le nombre de personnes âgées à charge augmente en conséquence ; des problèmes écologiques horribles qui entraînent une pénurie d'eau et polluent l'air de nombreuses villes ; et, à en juger par les mesures omniprésentes et énormément coûteuses prises pour assurer la sécurité intérieure, une crainte largement répandue que le régime communiste ne soit pas éternel et qu'il entraîne avec lui une grande partie du pays lors de son effondrement.
Il s'agit là de problèmes sérieux qui pourraient bien déboucher sur une crise qui a de nombreux antécédents dans l'histoire chinoise et qui a fait des dizaines, voire des centaines de millions de victimes rien qu'au cours des 200 dernières années. Néanmoins, ce pays désormais très industrialisé et comptant 1,3 milliard d'habitants - plus que les Etats-Unis, le reste de l'OTAN et la Russie réunis - ne se laissera pas si facilement détourner de ses objectifs impériaux.
Mais le plus important est que la Chine n'est pas et n'a jamais été qu'une structure politique que l'on peut qualifier d'État, mais une civilisation. En tant que telle, elle est à peu près aussi vieille que les pyramides. Rien que pour cela, il y a de bonnes chances qu'elle subsiste aussi longtemps que celles-ci.
Martin van Creveld est un historien et théoricien militaire israélien. Né aux Pays-Bas, il a vécu en Israël depuis sa plus jeune enfance. Il est diplômé de la London School of Economics, et de l'Université hébraïque de Jérusalem où il enseigne depuis 1971.
Traduit de l’allemand